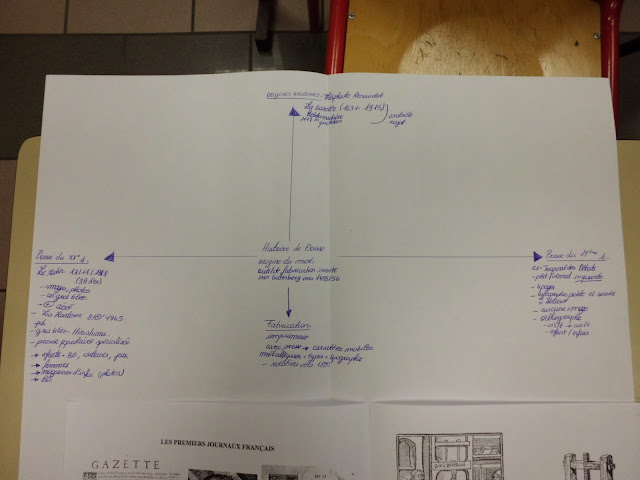Les élèves du groupe 1 de Littérature et Société ont travaillé dur avec leurs professeurs afin de mettre en scène un poème de Guillaume Apollinaire, "Du coton dans les oreilles". Ils ont répété pendant plusieurs séances un texte assez difficile qui décrit la vie des soldats dans les tranchées de Champagne en 1915, avec un bombardement assourdissant qui se calme peu à peu pour laisser place au bruit de la pluie. Ils ont revêtu des vestes d'uniforme et, avec des draps, ils ont réalisé une tranchée stylisée. Une bande-son accompagnait cette animation: le bombardement de la scène de l'attaque des Croix de Bois de Raymond Bernard (1932) pour le début du poème, la Marche Lorraine puis le bruit de la pluie qui tombe pour la fin du poème. Cette "sonorisation" a été faite grâce à l'équipement vidéo et audio de la salle, avec la projection d'un extrait du film mentionné et d'un paysage sous la pluie, depuis YouTube.
Ce soir, malgré un trac important, les élèves ont joué devant la classe de P S 01 qui doit présenter le poème à l'épreuve de Français du baccalauréat, et ils ont impressionné leur public. Bravo à eux ! Un goûter a permis aux artistes de décompresser car ils ont pris très à coeur leur prestation.
Une mise en scène du poème
Ce poème d'Apollinaire peut se prêter à une mise en scène. En effet, "Du coton dans les oreilles" évoque le front de Champagne en 1915. C'est un parcours qu'effectue le poète, depuis les positions de l'artillerie qui déchaîne son feu (d'où le titre) jusqu'aux tranchées de première ligne, finalement silencieuses.
Le texte est conçu comme une alternance de calligrammes (le début du poème avec le tir d'artillerie, la pluie qui tombe et le périscope) et de vers libres. Certains passages sont assez difficiles à comprendre et il faut à nouveau se plonger en 1915, en Champagne, pour les éclaircir.
De plus, le manuscrit du poème, présenté lors de l'Exposition "Apollinaire, le regard du poète" à Paris en 2016, et reproduit in extenso dans le catalogue (p. 268 - 276), permet aussi de mieux saisir le sens du poème: le premier calligramme a bien la forme d'un mégaphone dont l'extrémité serait tournée vers le lecteur, tandis que les premiers vers forment des arcs de cercle au dessus: cela ressemble à des courbes de tir (voir notre article du 26 janvier 2015) utilisées pour le calcul des trajectoires, soit dans les manuels d'artillerie soit par les instruments de visée. Un autre calligramme, ayant l'aspect d'un insigne de l'artillerie (une grenade avec deux canons entrecroisés) ne figure plus dans la version imprimée du poème et il y a eu des corrections, par exemple:
"Le silence des photographes
Mitrailleuses des cinémas"
qui devient "Le silence des phonographes...".
Les derniers vers ("Mais appelez donc Napoléon...") prennent l'aspect d'un casque Adrian, ce qui n'apparaît plus dans la version imprimée.
Quel commentaire (succinct) peut-on faire ?
Le poète est soumis à un feu intense de l'artillerie qui tonne depuis sa batterie :"Tant d'explosifs sur le point VIF !". Ce bruit infernal, souligné par le calligramme "O Mégaphone", vrille son esprit qui pourtant reste clair: les artilleurs déchaînent un tir violent avec un bruit assourdissant nécessitant l'usage d'un mégaphone. Apollinaire décrit alors des scènes de la bataille tandis qu'un téléphoniste tente vainement d'appeler le Bois de la Truie, position française située en avant du secteur des Hurlus, d'où l'anaphore "allô la Truie ?".
 |
| "Et les trajectoires cabrées Trébuchements de soleils-nains". Un obus éclate sur le parapet d'une tranchée aux Hurlus en 1915. |
Tandis que rôde la mort venue du Nord (le secteur allemand), près de l'abri nommé "Les Cénobites Tranquilles" (tout le monde aura compris l'allusion grivoise...), une sentinelle veille dans la tranchée autour de laquelle poussent les coquelicots qui ressemblent à des taches de sang. Un soldat semble s'être saoulé mais "sans pinard et sans tacot" (mots d'argot militaire pour le vin et le tabac) mais avec de l'eau: sans doute a-t-il été trempé par la pluie ?
 |
| "Et la cagnat s'appelait Les Cénobites Tranquilles". Abri aux Hurlus, 1915. |
Non loin de là, l'échelon, la base logistique de la batterie où se trouvent le matériel, les munitions et les attelages, s'agite avec des chevaux qui piaffent tandis qu'éclatent les obus semblables à des "soleils-nains" qui auraient trébuché en tombant au sol, et que les canons, comme assoiffés d'obus, répondent vivement en crachant des "fleurs de feu", avec la flamme sortant de la bouche du tube, formant une "lueur-frimas". En effet, la cadence de tir du canon de 75 était très élevée ( jusqu'à 20 - 28 coups par minute ! ) et les artilleurs enfournaient les obus dans la culasse avec célérité, comme pour donner à boire à la pièce ou la nourrir ... Ces obus étaient rangés dans un caisson, comme des bouteilles ...
 |
| La culasse du canon de 75. Centenaire de la libération de Sommepy, 30 septembre 2018. |
 |
| L'arrière-train de caisson avec les coffres pour le logement des obus, comme des casiers à bouteille ... Centenaire de la libération de Sommepy, 30 septembre 2018. |
 |
| Le déchaînement de l'artillerie avec une batterie de 75. "Puisque le canon avait soif". |
L'esprit du poète passe alors en revue une série d'images fulgurantes : l'étoile du Bénin, décoration coloniale donnée aux vétérans d'Afrique est associée à des boîtes de singe, c'est-à-dire des boîtes de conserve contenant de la viande que consommaient les soldats français (le singe faisant aussi allusion à l'Afrique), un soldat anglais (avec un jeu de mots sur "laid" et "frère de lait") est mentionné, tandis que le poète pleure en raison des gaz lacrymogène en mangeant du pain de Gênes, reçu probablement dans un colis.
 |
| L'étoile noire du Bénin, modèle officier. Collection particulière. "Il y a l'Etoile du Bénin Mais du singe en boîtes carrées" |
 |
| Un véritable et délicieux pain de Gênes dégusté en avril 2018 avec les élèves ! C'est un gâteau aux amandes, appelé aussi gâteau de voyage car on pouvait le transporter facilement et sans dommage. "Et je mangeais du pain de Gênes En respirant leurs gaz lacrymogènes" |
L'artillerie est encore évoquée longuement avec les voitures-caissons dont les roues, qui encadrent le canon, sont similaires à des horloges qui tournent, par le bruit infernal qui oblige les servants à mettre du coton dans les oreilles, par les fanions des signaleurs (sorte de drapeaux que les patrouilles agitaient comme signaux optiques afin de faire rectifier le tir des canons). Le vers "la baleine a d'autres fanons" peut s'expliquer sans doute par le passage des voitures-caissons dans les flaques d'eau: les rayons des roues partiellement immergées peuvent évoquer des bouches de baleines avec leurs fanons.
 |
| "Quand s'en allèrent les canons Autour des roues heures à courir" |
 |
| Signaleurs d'artillerie dans la Somme en 1916. http://grande.guerre.pagesperso-orange.fr/somme.html "Evidemment les fanions Des signaleurs" |
Mais quel est le lien entre les baleines et l'artillerie ? Dans une de ses lettres, adressée le 14 septembre 1915 à Madeleine Pagès, Apollinaire mentionne que les fusées d'ogive des obus comportent des "trous" appelés évents destinés à fournir de l'air pour la combustion de la poudre contenue dans la fusée. Le terme "évent" est donc commun à l'artillerie et aux baleines... Ces baleines ont donc d'autres "fanons" (les lames cornées garnissant la mâchoires des cétacés) qui sont les fusées d'ogive qui éclatent (comme les obus) ... et qui obligent les soldats à se recroqueviller (donc à se "faner"...).
Soudainement, le bruit s'apaise progressivement avec de la musique militaire qui joue, puis la pluie qui tombe doucement, évoquée par un autre calligramme, pluie qui enveloppe le soldat qui se fond complètement avec le paysage boueux. Le vacarme assourdissant laisse place à des sons de plus en plus apaisants (musique puis clapotis de la pluie).
 |
| Un concert donné par l'armée dans un village. "Ici la musique militaire joue quelque chose". Collection particulière. |
 |
| Détail de la photo avec l'orchestre militaire. |
Puis le poète quitte le secteur des batteries d'artillerie en empruntant des boyaux qui le mènent dans les tranchées de première ligne. Le silence se fait peu à peu avec seulement le claquement des balles et le sifflement des obus tandis que des sentinelles veillent avec un périscope.
 |
| "Les longs boyaux où tu chemines ". Boyau des Hurlus, 1915. |
 |
| "Ne vois tu rien venir au Périscope". Tranchée aux Hurlus, 1915. |
Désormais le coton dans les oreilles n'est plus utile mais le téléphoniste n'a toujours pas eu sa communication avec le Bois de la Truie et il vaudrait mieux contacter la radio de la Tour Eiffel, alors utilisée comme centre de communication par l'armée française, pour passer l'appel. Tout s'apaise désormais sur le front, avec une sentinelle qui se gratte et avec le silence qui règne dans les caves servant d'abris.
 |
| "Et les regards des guetteurs las". Les Hurlus, 1915. |
Chaque élève du groupe a eu une partie du poème à réciter, mais tous les élèves ont hurlé "Vif" et "Omégaphone" afin de souligner le bruit. La scène de l'attaque du film "Les Croix de Bois" de Raymond Bernard (1932), avec les tirs d'artillerie, a été projetée avec un volume élevé, baissé peu à peu. Au moment où le poète évoque la musique militaire, un extrait de "La Marche Lorraine" a été diffusé avec une petite pause dans la récitation, puis le son de la pluie qui tombe a permis de "sonoriser" le calligramme correspondant.
Pour le décor, des tables recouvertes de draps blancs permettent d'évoquer les tranchées "aux lèvres blanches" de Champagne. Un casque anglais, un clairon, une bouteille de vin servent d'accessoires ainsi que quelques vestes d'uniforme trouvées dans un dépôt-vente. Des mégaphones et un périscope en carton, un fanion de signaleur reconstitué d'après une photo d'époque, un panneau "les Cénobites tranquilles", complètent l'ensemble.
 |
| Le périscope, le mégaphone et le fanion du signaleur. |
Le tout permet d'animer, sur une période de 4 minutes environ, le poème. Léa, qui a commencé, a interpellé l'auditoire en récitant sa partie le début du poème, avec les mots "vif" et "Omégaphone" hurlés par tous dans un mégaphone en carton, de même que la sentinelle qui s'est saoulée agite une bouteille de vin vide, de même que le signaleur agite son fanion ou que le soldat tient son périscope. Pendant la récitation d'un élève, les autres miment les sentinelles, un soldat anglais (avec le casque), se frottent les yeux à cause des gaz, prennent une pause martiale avec la diffusion de la Marche Lorraine, se grattent le cou à la fin du poème.
L'espace réduit d'une classe ne permet pas de grands effets mais la présence de l'écran du vidéoprojecteur, près du décor, permet d'animer la tranchée avec le film mentionné ou avec la pluie qui tombe.
Jérôme Janczukiewicz et Nathalie Lefoll